Matin Calme (2020), traduit du coréen par Kyungran Choi et Lise Charrin.
Un bel objet qui m’arrive entre les mains. Inclassable, déroutant. Ça n’est pas un thriller (tant mieux, j’aime pas trop) ni vraiment un polar (y a pas d’enquête) et encore moins ce qu’on appelle de la littérature blanche. Il est beau, il est gros (470 pages et pas écrites comme bien trop souvent – genre 6 mots par ligne – dans l’ouvrage contemporain qui, trop souvent aussi, veut se faire aussi gros que le bœuf). J’avoue avoir hésité à me lancer dedans, tant il s’éloigne de mes standards.
Comme d’habitude je ne vous raconterai pas l’histoire mais je précise qu’elle se situe dans l’extrême sud de la Corée, à Busan (port important) et se déroule dans les années quatre-vingt dix. J’attaque. Les premiers chapitres me questionnent : Ils posent le décor, l’époque et l’ambiance. Un peu comme un documentaire Arte. Je suis très vite perdu par les noms des lieux et des premiers personnages évoqués. Je mélange les hommes et les quartiers. J’ergote. Je me dis que j’aurais collé tout ça dans un prologue tellement ça me parait peu romanesque. Je découvrirai, en fin de lecture, un glossaire que j’aurais nettement préféré lire au début. Ça m’aurait rudement aidé. Et puis, au fil des pages, les lieux s’imposent, les personnages apparaissent, la vie naît. Entre rapidement en scène Huisu, caïd quadragénaire, qui est en réalité le sujet principal de l’histoire. Sa vie, ses errances, ses rapports aux autres, à lui-même. Tellement présent qu’il aurait très bien pu être le narrateur. Je vous le dis de suite, on s’y attache fort à ce bonhomme. On en oublie presque les nombreux autres protagonistes qui fourmillent, apparaissent, disparaissent, reviennent. Et tant mieux parce qu’au début j’ai eu du mal à distinguer Yangdong de Yongkang, deux hiérarques de la mafia locale que tout oppose. Et les autres c’est pareil, faut se les coltiner quand on n’a pas l’habitude. J’assimilais allègrement les noms de quartiers (Yeongdo, Wollong etc.) à des chefs de gangs. J’ai la chance de connaître un tout petit peu la Corée et ça m’a beaucoup aidé. Je pense qu’il serait utile, au même titre que le « prologue » (premiers chapitres) et le glossaire (dernières pages du bouquin), d’expliquer un peu au lecteur franchouillard (que nous sommes tous) qu’en Corée, ça ne se passe pas du tout comme chez nous en ce qui concerne les rapports humains, les hiérarchies, l’éducation. Pour faire dans le très simple, le respect dû est proportionnel à l’âge de l’interlocuteur. Même chez les pires truands, même chez les éventreurs au couteau à sashimi. Très difficile d’avoir la moindre autorité envers un ainé (même s’il n’a qu’un an de plus). C’est comme ça. L’avancée sociale, dans le banditisme, la mafia et la voyoucratie est kif-kif la même que dans l’entreprise. Il faut prendre beaucoup de gants pour « commander » un plus vieux que soi. Le pauvre Huisu, notre quadra, se fait aisément respecter des jeunes voyous qui l’appellent « grand frère » mais pour se frayer un chemin en amont, envers ceux qu’il nomme « Père », « Patron » ou « Doyen », il n’a guère d’autre moyen que la machette (le couteau à sashimi est parfait). On ne cesse de respecter un vieux que quand il a servi (broyé bien sûr) d’aliment pour l’élevage de flétans du coin. La magie c’est que, au fur et à mesure qu’on avance dans la lecture, ces concepts nous deviennent familiers. On sépare les lieux des bonshommes, on distingue Yongkang de Yangdong, on s’acclimate. Et quel beau voyage que de suivre ainsi les hauts et les bas de ce héros si ordinaire qu’on s’y identifie avec étonnement. L’histoire nous passionne car elle nous fait sortir réellement de notre quotidien (qui est sans doute aussi très exotique pour un coréen). Là aussi, on voyage. On visite en imaginant les lieux à partir de ce qu’on connaît de ce pays (c’est-à-dire rien). Les mécanismes économiques, les rouages de la société y sont clairement sous la coupe des « parrains» (ce mot n’est pas utilisé) de la mafia locale. Tout se fait sans grandes formalités, à coups de bakchichs, d’influences et, surtout, de couteaux. Jamais rien n’est acquis, tout va de travers, faut pas trop faire le délicat, celui qui plante l’autre le premier, gagne. En gros faut suivre l’ainé qui vous portera le plus loin sans trop se poser de questions ni hésiter à le trahir si, bien sûr, c’est pour rallier un autre ainé plus solide. La place des femmes, dans ce bouquin, est très « coréenne des années quatre-vingt dix » c’est-à-dire inexistante. La seule qui a une petite place est Insuk une ex-prostituée qui, de part sa carrière, est un peu le dénominateur commun à tous les protagonistes. Les autres, qu’on ne voit jamais, sont marchandes ambulantes ou préparent le Kimchi à la maison pour au cas où le mari repasserait à l’improviste. Mais ne jugeons pas trop vite, souvenons-nous d’où on vient en la matière. Huisu avance donc, dans son petit monde, à coups de couteau (reçus ou donnés). En le suivant ainsi, au fil des pages, on apprend énormément, on s’ouvre l’esprit. Un chapitre intitulé « Funérailles » décrit tout ce qu’il faut savoir (c’est d’ailleurs le plus long du livre). Pour le coréen, comme pour tout peuple dont les blessures saignent encore, les repas sont essentiels, un art de vivre, un moyen de paraître. Et là on en a pour son argent. Ça en avale de la viande. De toutes sortes. Même les plus vieux, les intouchables, ceux à qui tout appartient, passent leurs journées à consommer du bouillon… de viande. On en salive avec eux. C’est même un grand rituel qu’on réserve, dans le milieu, à ceux qu’on va découper en morceaux une fois le dernier verre de Soju avalé. Le raffinement, dans la découpe, est le même pour le barbecue que pour le supplicié. Respect !
Contrairement à nos thrillers, où tout est fait pour séduire le lecteur (on n’a plus rien inventé depuis Thierry Jonquet), ici il convient de faire un effort pour embarquer. Mais quel voyage où on retrouve l’inventivité et la démesure du cinéma coréen et, par de nombreux aspects, la démence des films des frères Coen ! Quand on le referme on se demande où sont passés Busan et ses quartiers. On file sur Google pour s’accrocher un peu au décor, le rendre tangible, l’empêcher de s’évaporer définitivement. On sait que, là-bas, quelque part, Huisu continue son chemin. Le temps a passé. Aujourd’hui on doit l’appeler Père ou Doyen Huisu. À moins qu’il ne se soit réincarné en flétan.
Merci à Gunhee Cho pour sa participation à la photo 😉



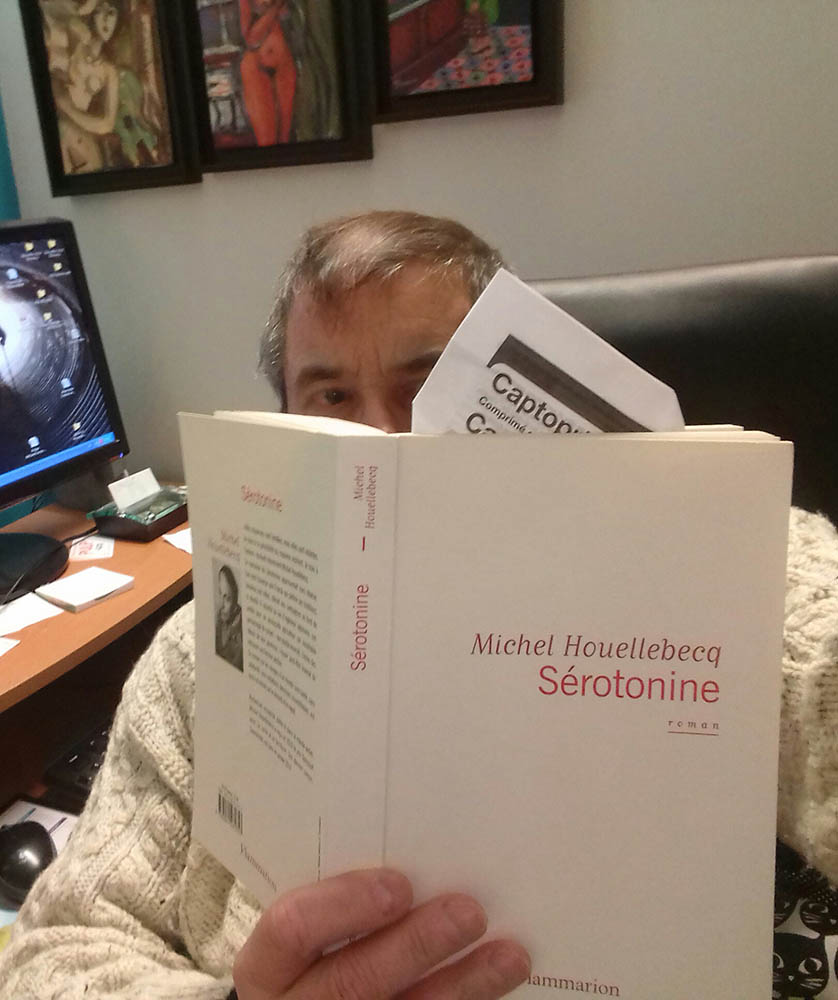

0 commentaires